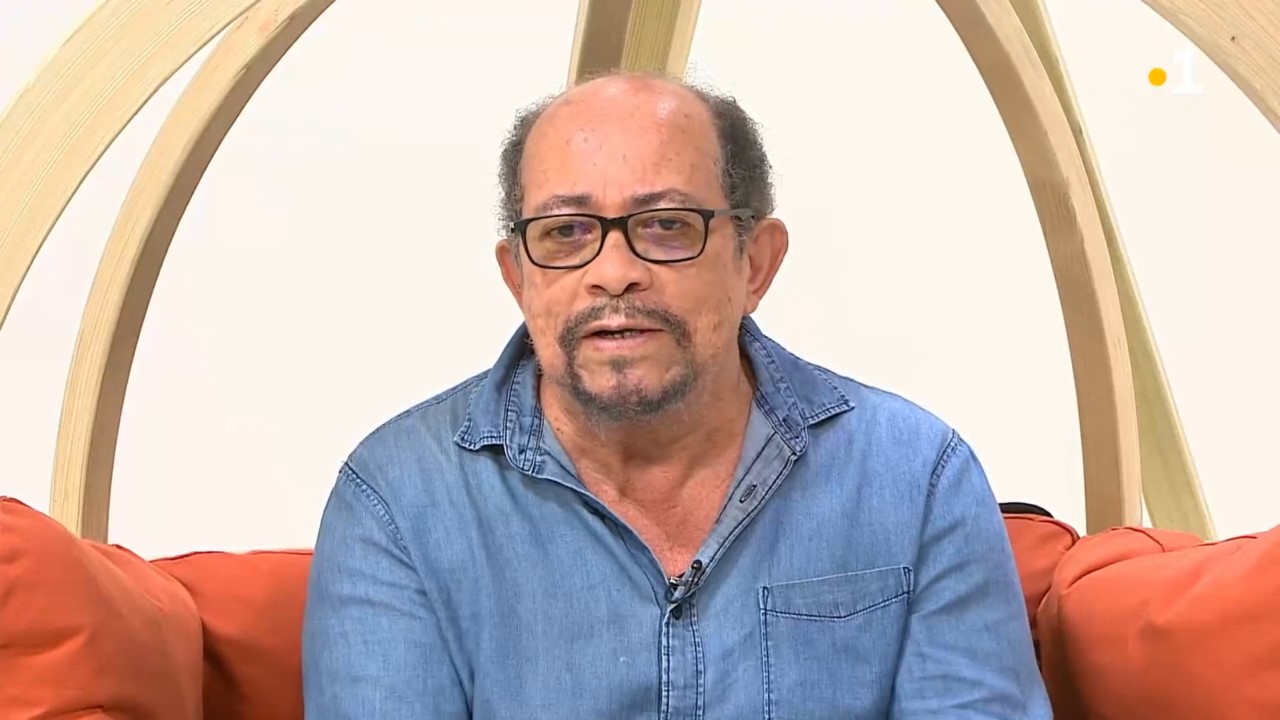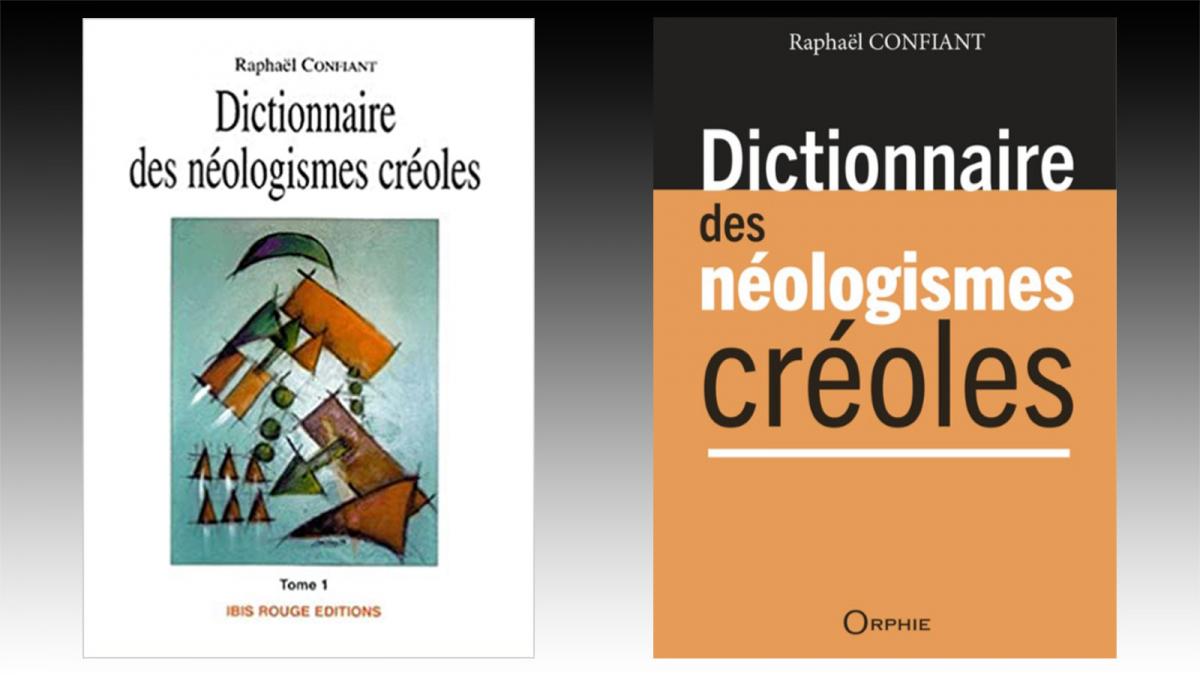Créolité et francophonie: un éloge de la diversalité
Raphaël Confiant

En guise d’en-allée
Longtemps cette langue nous fut étrangère, langue du colon découvreur d’Amériques, langue du Planteur esclavagiste, langue d’une métropole qui nous qualifia plus tard de «confettis de l’Empire». Pendant trois siècles, les Noirs des Antilles françaises (Saint-Domingue, devenue Haïti, jusqu’en 1804, Martinique, Guadeloupe et Guyane) n’eurent pas le droit de l’apprendre. Aux maîtres blancs, le sinistre «Code Noir» (1685), qui régissait les rapports entre maîtres et esclaves, interdit aux premiers d’enseigner aux seconds l’art de la lecture et de l’écriture. Dans le même temps, empêchés de continuer à parler nos langues d’origines, celle de l’Afrique perdue, c’est-à-dire l’éwé, le fon, l’ibo ou le wolof, nous inventâmes de toutes pièces un nouvel idiome, le créole, qui nous permit de survivre au sein de l’univers plantationnaire. C’est dans celle-ci, que, de concert avec les maîtres qui n’eurent d’autre ressource que de se l’approprier, nous nous sommes réinventés en tant qu’êtres humains puisque le commerce triangulaire avait fait de nous de simples marchandises, du «bois d’ébène» disait-on à l’époque.
Nous avons donc confié au créole l’entièreté de nos souffrances, de nos espoirs, de nos rêves, de notre rage qui éclatait parfois en révoltes vite matées dans le sang. Tout cela peut encore se lire à travers les contes de nos veillées, les devinettes, les proverbes, les comptines et surtout les chants. Ils disent la blessure intérieure, «le chant profond du jamais refermé» selon l’expression d’Aimé Césaire (Moi, laminaire, 1992). Vint l’Abolition de l’esclavage en 1848 et notre désir, compréhensible, de devenir des citoyens à part entière c’est-à-dire des hommes libres. Alors nous décidâmes d’oublier d’un seul coup le temps du fouet et de l’insulte, d’effacer de nos mémoires non seulement le souvenir de ces trois siècles d’abaissement de nos peuples mais même celui du continent originel qu’on nous avait patiemment appris, il est vrai, à mépriser. Et le sésame de cette accession rêvée au statut d’homme et de citoyen fut d’abord et avant tout l’acquisition de la langue française, l’acquisition rapide, parfaite des moindres arcanes d’une langue que les esclaves avaient à la fois haï et désirée.
Désormais, en cette seconde moitié du XIXè siècle, ce désir pouvait se donner libre cours et surtout s’allier à la nécessité car dans la nouvelle société qui se mettait en place, le créole commençait à perdre de son importance en tant qu’organe de communication unique puisque l’école s’ouvrait aux fils d’esclaves. Pour réussir, pour grimper dans l’échelle sociale, la maîtrise du français — du meilleur français — devint un impératif catégorique. Jusqu’au mitan du XXè siècle, un phénomène d’idolâtrisation de la langue de Molière se propagea dans nos sociétés antillaises, du plus riche Mulâtre jusqu’au Noir ou à l’Indien le plus démuni. Seuls les anciens maîtres blancs demeurèrent à l’écart de cette frénésie linguistique puisqu’ils parlaient déjà le français et surtout se voyaient déposséder du monopole de cette dernière par des gens qu’ils considéraient hier comme des sous-hommes.
Parler français devint une «distinction» sociale au sens où l’entend Pierre Bourdieu, la marque de ce que l’on avait réussi à gravir les marches de la Civilisation, de la seule qui méritât ce nom, la civilisation française et plus largement occidentale. Nos poètes se voulurent Romantiques, Parnassiens, Symbolistes et plus tard Surréalistes. Nous nagions en plein «bovarysme collectif» selon le mot cruel et juste de l’Haïtien Jean-Price Mars (Ainsi parla l’Oncle, 1925. Temps de décentrement, d’aliénation, d’oubli de soi, de rejet total de la langue et de la culture créoles. Temps des peaux noires et des masques blancs pour paraphraser Frantz Fanon. Puis vint le doute, l’hésitation, cela à partir des années 60 du XXè siècle. Doute qu’avait instillé dès les années 30, le mouvement de la Négritude et qu’Edouard Glissant et sa théorie de l’Antillanité vint conforter en pleine guerre d’Algérie et au moment même où les colonies d’Afrique noire française accédaient à l’indépendance. Nous redécouvrions la «poétique» de la langue créole, ses beautés cachées, sa force rebelle, son ironie mordante, son allégresse impudique. Notre français cessait peu à peu de faire la révérence à l’Académie et intégrait des vocables nouveaux, interdits jusque là, des vocables créoles. Peu à peu, cette langue s’autochtonisait, prenait racine dans les îles, commençait à exprimer nos sentiments les plus profonds et ce faisant, elle perdait du même coup sa belle raideur racinienne que l’école nous avait présenté comme son unique parure.
Dans les ultimes décennies du XXè siècle, on assista à un double mouvement : l’accession du créole à l’univers de l’écrit accompagné de l’explosion d’une littérature de qualité dans cette langue et l’appropriation du français par les Antillais, désormais décomplexés face aux exigences de Malherbe, Vaugelas et Grévisse. De toute cette trame historique et culturelle est né, vers les années 80, le mouvement de la Créolité dont les Martiniquais Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant (Eloge de la Créolité, 1989) et le Guadeloupéen Ernest Pépin furent les plus ardents promoteurs. Nous savions enfin que nous avions deux langues - l’une légitime, le créole; l’autre adoptive, le français - et qu’il nous faudrait composer avec cette réalité. Sortir de la névrose linguistique qui avait poussé nos parents à idolâtrer le français et à rejeter le créole pour arriver à une situation d’équilibre entre ces deux idiomes, une relation de non-conflictualité en tout cas. Le mouvement général du monde — appellé «mondialisation» ou «globalisation» et que nous préférons appeler «créolisation» — nous aidait grandement à penser notre situation particulière sans nombrilisme et surtout dans un esprit d’ouverture à toutes les langues du monde. L’anglais, l’espagnol, le hollandais et le papiamento, langues de l’archipel caraïbe, frappaient à nos portes à travers le disque et le CD, le cinéma, les voyages désormais facilités et l’immigration inter-insulaire. Nous étions dès lors sommés d’inventer la Diversalité.
Les leçons de l’expérience antillaise
Nous n’avons pas la prétention de dire que les Antilles sont un modèle pour la nouvelle humanité «globalisée» qui est en train de se construire sous nos yeux mais il n’en reste pas moins que c’est la première fois, dans l’histoire de l’humanité, qu’une société s’est constituée à partir d’un véritable laboratoire humain. Partout, dans le passé, des peuples ont envahi d’autres peuples, des empires se sont constitués — empire romain, empire arabe, empire ottoman, empire anglais et français — mais la confrontation s’établissait toujours entre des autochtones, souvent farouchement attachés à leurs traditions, et des conquérants désireux d’implanter les leurs par la force. Dans le Nouveau Monde, au contraire, dont les Antilles furent la préfiguration et la métaphore tout à la fois, des souches humaines se sont implantées/ont été implantées comme pour former un véritable « bouillon de cultures » au sens où l’entendent les sciences naturelles. Une fois les autochtones amérindiens totalement exterminés (cela pris entre vint et quarante ans selon les îles à partir de 1492 pour les Grandes Antilles et 1625 pour les Petites), elles devinrent des territoires vierges, presque sans mémoire, libres en tout cas de toute attache mythique ou historique. C’est dans les Antilles que s’est réalisée une première globalisation du monde, cela dès la fin du XVIIè siècle.
Trois civilisations extrêmement différentes se sont entrechoquées sur des territoires minuscules, l’Amérindienne, vite éliminée (mais point totalement effacée, «désapparue» comme dit E. Glissant et non pas « disparue »), l’Européenne, conquérante, brillante et l’Africaine, vaincue, humiliée. Trois types d’humanité, trois imaginaires, trois destins. Plus tard, au XIXè siècle, de nouvelles souches humaines furent introduites — Indiens de l’Inde, Chinois et Syro-Libanais — élargissant ainsi le spectre de la créolisation. Car c’est de cette manière qu’il convient de nommer ce phénomène inédit de brassage culturel de peuples originaires de quatre continents (seule l'Océanie n’a pas contribué à la formation du Nouveau Monde): créolisation. Que signifie ce mot? D’où vient-il? Qu’est-ce qu’un Créole?
La réponse est à la fois simple et compliquée : «créole» provient du latin «creare» qui signifie en français «créer/être créé». Il désigne, dans son étymologie même, la nouveauté, l’artificialité, l’inouï de ces sociétés qui sont nées de ce fameux bouillon de cultures que nous avons évoqué plus haut. Il désigne un monde neuf. Maëlstrom humain, culturel, linguistique et religieux comme le décrit Edouard Glissant (Le Discours antillais, 1981) qui n’a pas abouti à un mélange harmonieux ou en tout cas complet comme cela a pu se produire dans l’Ancien monde où Gallo-romains et Arabo-berbères, par exemple, se sont mêlés jusqu’à ce que l’on ne puisse guère plus reconnaître ce qui tient de l’autochtone et du conquérant. Aux Antilles, le mélange s’est fait sous le mode de la diffraction, de l’hétéroclite, du «bricolage culturel» au sens de Lévi-Strauss et loin de fusionner jusqu’à effacer les traces de leurs origines, les apports culturels des quatre continents se sont ici agrégés là juxtaposés sans presque jamais perdre disparaître en tant que tels.
Le Créole ne possède pas une nouvelle identité comme le Gallo-romain ou l’Arabo-berbère mais de nouvelles identités. Le phénomène de créolisation a inventé de toutes pièces l’identité multiple. Alors que dans l’Ancien Monde, il est impensable d’être à la fois Juif, chrétien et musulman, dans le Nouveau, où il y a «surabondance de Dieux» comme l’écrit joliment Simone Henry-Valmore (Dieux en exil, 1976), chacun assume ou partage plusieurs identités religieuses à la fois: la même personne peut se rendre à une messe catholique le matin, participer à une cérémonie hindouiste l’après-midi et aller consulter un sorcier nègre à la faveur de la nuit. Cela sans y voir la moindre contradiction, la moindre incongruité. Jésus, Mariemen et Papa Legba cohabitent chez le Créole, certes pas de manière oeucuménique, mais comme des pans de l’identité de chacun, pans qui se mêlent et se démêlent sans cesse, qui s’embrassent et s’excluent dans un même élan. Et ce qui est vrai du religieux l’est tout autant du culinaire, du vestimentaire, de l’architectural, du technologique et bien entendu du linguistique. Identité multiple donc dans laquelle les auteurs de l’Eloge de la Créolité ont vu une préfiguration de cette globalisation qui nous affecte en ce début du troisième millénaire.
Il y a donc des leçons à tirer de l’expérience antillaise. Née du plus grand déni d’humanité jamais commis — l’esclavage des Noirs africains (entre 30 et 70 millions d’hommes arrachés à leur terre natale et déportés dans un univers inconnu et hostile) —, s’étant développée au sein d’un monde concentrationnaire — la Plantation de canne à sucre —, résistant aujourd’hui à la francisation totale et à la globalisation anglo-américano-saxonne, la civilisation créole, dans sa déclinaison française, qui s’est développée des bayous de la Louisiane aux confins de l’Amazonie guyanaise, en englobant Haïti, la Guadeloupe, la Dominique, la Martinique et Sainte-Lucie, est un formidable outil pour nous permettre de penser le monde à venir. Au plan linguistique qui nous intéresse plus particulièrement ici, elle nous clame que toutes les langues sont belles, que toutes ont droit à l’existence et que si lorsqu’un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle comme l’écrivait Amadou Hampate Ba, lorsqu’une langue disparaît, c’est tout un pan de l’imaginaire mondial qui est à jamais perdu. C’est un appauvrissement de l’humanité, un rétrécissement de la conscience.
La guerre des langues
Pendant trois bons siècles, la langue française a mené une guerre sans merci contre la langue créole qu’elle s’acharnât à désigner sous les vocables péjoratifs de «jargon des Nègres», de « patois », de « baragouin » et plus récemment de «petit-nègre». Elle s’est posée, ici mais aussi en Europe, comme la langue de la Raison, de la Logique et du Beau et cela contre toute logique puisque Descartes lui-même écrivait, au tout début de son Discours de la Méthode, que la raison est la chose au monde la mieux partagée. Or, le monde parle une multitude langues! Langues toutes égales, quoique différentes, dans leur manière de découper le réel et de servir aux besoins communicatifs des communautés qui les utilisent, n’en déplaise à Rivarol. On ne voit pas en quoi, en effet, J’ai mal à la tête serait plus logique que l’espagnol Me duele la cabeza ou le créole Tet mwen ka fè mwen mal qui signifient tous deux, littéralement, Ma tête me fait mal. Dans pareille idée, il n’y a qu’aveuglement ethnocentriste.
La guerre menée par le français contre le créole a imprimé un fort sentiment de culpabilité linguistique dans la psyche des Antillais, sentiment qui a conduit certains au bord du suicide linguistique : ne plus vouloir parler cette langue pourtant ancestrale et interdire aux enfants de l’utiliser. A l’école, nos maîtres, longtemps pourchassèrent ce qu’ils appelaient les «créolismes» c’est-à-dire l’intrusion subreptice de la langue dominée au cœur même de la langue dominante. Ils se firent les plus ardents défenseurs de la norme parisienne alors même qu’ils étaient incapables, ne serait-ce qu’au plan phonologique, de l’atteindre tout à fait. Traumatisme de la pseudo-absence du r en créole dont Fanon s’est bien gaussé. Mensonge d’ailleurs puisque c’étaient les premiers colons normands qui disaient paler au lieu de parler alors que leurs esclaves africains roulaient les r plutôt deux fois qu’une, chose qui se remarque d’emblée aujourd’hui dans le français d’Afrique noire. Cette guerre a fait des victimes: enfants des classes populaires et donc créolophones brutalement exclus du système scolaire, travailleurs bloqués dans leur carrière par une maîtrise insuffisante du français et même dans la petite-bourgeoisie, puissant sentiment d’insécurité linguistique conduisant parfois à des hypercorrections.
A ce traumatisme, Aimé Césaire, dans les années 30, a voulu riposter en déclarant vouloir «négrifier la langue française». Désir louable mais impossible à mettre en œuvre si l’on de dispose pas d’une langue «nègre» sous la main. Or, on le sait, comme tout Antillais, l’auteur du Cahier d’un retour au pays natal (1939) ne parlait aucune langue africaine et de plus, il tournait le dos au créole, symbole pour lui de la promiscuité coloniale et de la compromission entre maîtres blancs et esclaves noirs. Son désir est donc resté lettre morte mais sa simple formulation témoignait du mal-être linguistique qui étreignait les élites antillaises en cette première moitié du XXè siècle.
Il a donc fallu attendre Edouard Glissant dans les années 60, puis les auteurs de la Créolité dans les années 80 pour que le désir césairien puisse commencer à s’exaucer. L’hybridation du français et du créole était alors revendiquée comme l’une des tâches primordiales de nos écrivains afin de pouvoir trouver/construire leur propre langage. Car au-delà de la langue en tant qu’outil linguistique, il y a le discours, la vision du monde qui, pour trouver son originalité, ne peut en aucun cas considérer la langue comme un objet neutre. Le français de France charrie en lui des siècles et des siècles d’expérience hexagonale et ne saurait impunément être utilisé par des écrivains non-Hexagonaux sous peine de se voir déporter, à leur insu parfois, de leur identité propre.
La première leçon que nous enseigne l’expérience antillaise est que le français doit être acclimaté aux nouvelles régions où il s’est installé, il doit s’adapter à de nouvelles cultures, à de nouveaux imaginaires. Il doit surtout ne pas résister à un certain métissage avec les langues déjà installées qu’il est journellement amené à côtoyer. Les linguistes qualifient ce phénomène de «nativisation du français» et la racine de ce mot, «naître», renvoie à celle du mot «créole» qui est «créer». Un nouveau français doit naître, doit se créer partout où la langue de Molière a trouvé à s’installer. Non pas une langue entièrement différente mais une variété de français qui a sa propre couleur, sa propre odeur, ses propres élans et qui, par ricochet, à vocation à enrichir la langue de l’ancienne métropole.
La seconde leçon que nous devons tirer du processus de créolisation, c’est que les langues locales, tribales, régionales ou nationales — basque, corse, breton, occitan, créole, wolof, bamiléké, malgache ou arabo-berbère — ne menacent aucunement le français, qu’elles n’empêchent point sa diffusion et qu’elles doivent être étudiées et enseignées au même titre que le français. Chacun sait que le nombre de francophones a doublé en Afrique noire après les indépendances des années 60, qu’il a triplé en Algérie malgré la politique d’arabisation. Que là où le français se porte le mieux, c’est dans les régions où il y a eu une prise en compte, limitée certes, des langues locales (Mali, Bénin, République Centre-africaine, île Maurice).
La troisième leçon est qu’aujourd’hui, le meilleur allié du français contre l’hégémonisme anglo-américain, ce sont les langues régionales de l’Hexagone (breton, corse, basque etc.) et les langues indigènes des anciennes colonies. Car à se battre comme il continue, hélas, à le faire sur deux fronts : d’une part contre les langues régionales et indigènes et d’autre part, contre l’anglo-américain, le français risque à terme de s’épuiser et de s’appauvrir. L’exemple d’Haïti est très éclairant à cet égard: faute, pour la Coopération française d’avoir résolument soutenu l’introduction du créole dans le système scolaire haïtien, le français est en passe de nos jours d’être remplacé par l’anglo-américain. Il y a désormais autant d’Haïtiens qui parlent le français que la langue de l’Oncle Sam et la tendance dominante est celle d’une diminution inexorable du premier groupe. Or, le créole ne comportait aucune menace sérieuse pour le français et bien au contraire, ceux qui avaient d’abord été alphabétisés dans leur langue maternelle apprenaient ensuite plus rapidement et mieux le français ! Aveuglement d’une francophonie impérialiste et finalement auto-destructrice.
La question de la norme
Qui dit français nativisé, indigénisé, dit norme endogène. Or, la France est l’un des rares pays dans le monde où il y a une véritable fétichisation de la norme. Impossible de devenir présentateur-vedette du journal télévisé sur une grande chaîne nationale, agrégé de Lettres, ministre ou même grand acteur de cinéma si l’on conserve l’accent de sa province. Yves Montand a maintes fois raconté combien d’efforts il avait été amené à faire lorsque, jeune Marseillais monté à Paris pour faire une carrière cinématographique, il avait été contraint de gommer son accent méridional. Ce dernier, tout comme l’accent alsacien, bourguignon, créole ou africain, est sans cesse moqué, ridiculisé. Mais il n’y a pas que l’accent: depuis que Malherbe avait entrepris de «dégasconner la langue française» au XVIIè siècle, le français s’est privé d’étonnantes richesses dialectales et s’est figé, voire étiolé dans une parlure parisiano-bourgeoise qui sent parfois le chloroforme. Que de mots perdus à jamais, d’expressions, d’images envolées !
Quand on la compare avec les littératures allemande ou italienne qui n’hésitent pas à puiser dans le trésor de leurs dialectes, on mesure la perte qui a résulté, pour la littérature française, de l’imposition presque militaire (cf. l’enquête de l’Abbé Grégoire, pendant la Révolution française, « sur les patois de France et les moyens de les éradiquer ») d’une langue qui, au départ, n’était parlée que par une modeste fraction de la population de l’Ile-de-France.
A l’heure de la mondialisation, cette fétichisation de la norme confine au ridicule le plus absolu. D’autant que l’adversaire principal, l’anglo-américain se fiche royalement d’une telle contrainte. Personne ne fait attention à votre accent, ou en tout cas ne vous en tient rigueur, quand vous postulez pour un emploi, passer l’oral d’un examen ou jouez dans un film. Accents australien, néo-zélandais, africain, indo-pakistanais, sud-étasunien, nord-étasunien, californien, caribéen ne souffrent d’aucune discrimination particulière par rapport à l’accent british lequel se divise déjà entre accents anglais, gallois, écossais et nord-irlandais.
Et cela est aussi vrai du lexique: le Harrap’s accueille chaque année des centaines de mots indo-pakistanais, caribéens, africains ou étasuniens alors que le Robert est particulièrement frileux, y compris envers ce qu’il nomme pudiquement les «canadianismes». Le grotesque est d’ailleurs atteint lorsqu’au lieu d’adopter le beau néologisme québecquois de courriel pour dire e-mail, l’Académie française tente froidement de nous imposer mél. Autrement dit, le franglais vaut mieux que les français indigènes ! ! !
Il est donc temps pour l’Hexagone de reconnaître qu’il n’est plus le seul centre de production du français et donc de la norme et qu’il existe depuis bientôt un siècle des lieux où le français est aussi vivace, aussi dynamique que sur les bords de la Seine. Que dans ces lieux de nouveaux types de français s’élaborent et donc de nouvelles normes, des normes endogènes qui ne sont en rien inférieures à celle de Paris. Qu’elles ont droit au respect parce qu’elles témoignent non pas de l’appauvrissement de la langue mais de son enrichissement par l’apport d’imaginaires différents. En couronnant l’Acadienne Antonine Maillet en 1979 pour Pélagie-la-charrette et le Martiniquais Patrick Chamoiseau en 1992 pour Texaco, les académiciens du Prix Goncourt ont montré la voie à suivre, la seule manière pour le français de résister à l’avancée de l’anglo-américain.
Un simple exemple, butal, sec: après cinq ou dix années de scolarité plus ou moins chaotique, l’Haïtien moyen parvient à peine à articuler une phrase correcte en français alors que lorsqu’il émigre aux USA, au bout de sis mois, il parle déjà anglais relativement couramment! Pourquoi? Parce que l’anglais serait plus facile que le français? Absolument pas! La raison est la suivante :en français, il est paralysé par l’épée de Damoclès d’une norme rigide, il crève de peur de commettre des fautes alors qu’en anglais, rien de tout cela ne pèse sur lui. Personne ne lui fera de remarque désobligeante sur son accent ou sur telle ou telle faute qu’il pourra inévitablement commettre au cours de son apprentissage.
Pour une Académie francophone
La mondialisation exige qu’à côté de l’Académie française soit fondée une Académie francophone. L’intégration de non-Hexagonaux au sein de la première (intégration dont Léopold Sédar Senghor est l’exemple le plus connu) ne suffit plus. Au mitan du troisième millénaire, il y aura davantage de locuteurs du français hors de l’Hexagone qu’à l’intérieur de celui-ci, de locuteurs réels s’entend, pas de locuteurs « administratifs » (ces 70% d’Africains noirs, par exemple, qui vivent dans des états où le français est la langue officielle mais qui ne parlent pas un traître mot de français dans leur vie de tous les jours et qui ne le parleront jamais tant qu’on ne partira de l’enseignement de leurs propres langues pour leur enseigner le français). Cette Académie francophone sera définitivement installée dans l’Hexagone puisque ce dernier est le berceau historique de la langue française mais sa composition se fera au pro-rata des francophones réels. Ce qui veut dire que des pays de 400.000 habitants comme la Martinique ou la Guadeloupe devront y avoir davantage de sièges qu’un pays de 7 millions d’habitants comme Haïti qui ne compte que 200.000 francophones effectifs.
Cette Académie francophone devrait être co-financée par les pays francophones au pro-rata de leur PNB. Ce qui veut dire que le minuscule Luxembourg devra contribuer davantage que l’immense Mali, par exemple. A côté de cette Académie francophone mondiale devraient voir le jour des Académies francophones régionales non pas par pays mais par zone géographique: académie francophone des Amériques (Caraïbes, Guyane et Québec), académie francophone du Maghreb, académie francophone d’Afrique de l’Ouest etc. Ces dernières travailleraient à consolider ces fameuses normes endogènes dont nous avons parlé tout en maintenant les liens avec les autres variétés de français. Leur financement serait exclusivement à la charge des régions concernées, toujours au pro-rata de leurs nombre de francophones réels et de leur PNB. Le travail de ces Académies francophones régionales, tout comme celui de l’Académie française d’ailleurs, servirait de base préparatoire à deux sessions annuelles de l’Académie francophone mondiale dont l’une se tiendrait à Paris, l’autre dans chacune des régions francophones à tour de rôle. Le tout serait couronné par la publication d’un «Dictionnaire du français mondial» dans lequel les apports régionaux français d’une part et les apports africains maghrébins, antillais et canadiens de l’autre, trouveraient leur juste place.
Pour une utopie francophone
Le monde ne va pas sans utopies. C’est là le moteur des énergies intellectuelles. L’utopie francophone doit s’inscrire résolument dans la créolisation et dans la diversalité. Dans la créalisation d’abord comme modèle de mondialisation opposé au communautarisme anglo-américano-saxon. On le sait, aux USA, il n’y a jamais eu de «melting-pot» et les Chinois vivent leur sinitude dans Chinatown, les Noirs leur négritude dans les ghettos, les Hispaniques leur latinité dans les barrios et les Blancs leur caucasianité dans les white suburbs. C’est la théorie du separate but unequal (et non pas equal comme cela est mensongèrement affirmé) que Hollywood, CNN et Coca-Cola tentent d’imposer au monde entier. La juxtaposition des communautés. L’enfermement dans l’Identité Unique. En effet, devant la mondialisation inéluctable, inexorable qui se met en place, il n’y a qu’une alternative sérieuse: la créolisation ou Identité Multiple contre la globalisation communautariste sous égide étasunien ou Identité Unique. On sait les ravages récents de cette dernière en Bosnie ou au Rwanda. On sait moins qu’en juillet 2000, deux états américains, le Nouveau-Mexique et l’Arizona ont supprimé l’enseignement bilingue anglais-espagnol.
La francophonie doit tourner le dos à cette globalisation, et tout en promotionnant le français, déployer les mêmes efforts en faveur du créole, du wolof, du bambara, du kikongo, du berbère, de l’arabe, du tahitien ou des langues canaques. Et le principal effort consiste à aider à la fabrication d’ouvrages scolaires dans ces différentes langues d’une part et à la réalisation de productions télévisuelles, cinématographiques et multimédias (CDROM, site-Internet). Tout cela risque de coûter très cher mais, on le sait, les utopies n’ont pas de prix. Il y va de la crédibilité même de l’idée francophone qui dans un deuxième temps doit s’inscrire dans la perspective de ce que les auteurs de l’Eloge de la Créolité ont nommé la «Diversalité». En quoi ce néologisme se distingue-t-il de diversité? Pourquoi a-t-il été nécessaire de le forger? C’est parce qu’il y a risque que des esprits trop peu attentifs confondent mondialisation globalisée et mondialisation créole. La première valorise la «diversité» telle que l’exprime spectaculairement les publicités de Benneton où sont juxtaposées ce qu’une idéologie aux relents racistes appelle «les trois races»: la Blanche, la Noire et la Jaune. Du coup, la moitié de l’humanité — l’humanité métisse — est passée à la trappe: Indiens de l’Inde, Sud-Américains, Arabes, Juifs, peuples océaniens.
L’Amérique triomphante «blanche-anglo-saxonne-protestante» et ses affidés européens aiment à penser le monde en catégories étanches. Cela les rassure et leur permet de mieux le contrôler. Tout ce qui est métissage — biologique, linguistique ou religieux — les inquiètent et les dérangent. Au contraire, la mondialisation créole valorise la «diversalité» c’est-à-dire le mélange, le partage des ancêtres et des identités, le non-cloisonnement des imaginaires. Elle se distingue de l’idéologie sud-américaine du mestizaje qui se place uniquement sur le terrain biologique et qui ne voit la «solution» des problèmes «amérindien et noir» que dans la fusion à terme de ces derniers dans la «race blanche» considérée comme la pointe avancée de l’humanité. La Diversalité, suivant en cela les traces (et les stèles) de Victor Segalen, nous contraint de reconnaître que l’Autre vit en nous, que nous sommes partiellement lui et qu’à ce titre il a droit à notre respect le plus absolu. Le jazz, en dépit de la ségrégation inavouée qui sévit aux États-Unis, n’est plus depuis des lustres une «musique nègre» et la cuisine chinoise n’est plus, en Europe de l’Ouest, une cuisine exotique. C’est qu’il y a désormais du «nègre» et du «chinois» chez l’Européen et inversement. Nous partageons tous — et nous partagerons de plus en plus — les mêmes ancêtres, à des degrés divers bien entendu.
Final de compte
En français des Antilles (et en créole), pour dire «fin», on dit «final de compte». Pour bien montrer sans doute qu’au terme du raisonnement, rien ne doit être omis ou oublié, que le décompte scrupuleux des propositions est une exigence à la fois morale et intellectuelle. C’est pourquoi je termine en réparant un oubli: le français de l’Hexagone est en train de changer. Il est en proie à un bouleversement extraordinaire au sein de ces multiples banlieues où parfois vingt ou trente nationalités différentes sont sommées de vivre ensemble. Ce français-Djamel (pour reprendre le nom du célèbre humoriste de Canal+) est en passe de supplanter le français populaire-gaulois car il déborde les cités pour s’emparer des bouches et des esprits de toute la jeunesse française.
Il fait bouger le français, il décrispe la norme, il retrouve la créativité, l’inventivité insolente du français pré-malherbien, celui de François Villon et des poètes de sac et de cordes de la fin du Moyen-Age, celui de François Rabelais et de sa boulimie lexicale. Les décideurs actuels de la Francophonie doivent tenir compte de ce paramètre incontournable ainsi que de tous les autres que nous avons examinés plus haut s’ils veulent que dans le nouveau siècle qui s’annonce, la langue française ne devienne pas une langue marginale, s’ils veulent qu’elle continue à rayonner sur les cinq continents.
Raphaël CONFIANT
Ecrivain martiniquais
- Se connecter ou s'inscrire pour publier un commentaire
- 522 vues
Connexion utilisateur
Dans la même rubrique
Top 5 des articles
Aujourd'hui :
- Le suicide de Marny vu par Raphael Confiant, écrivain martiniquais et par Ernest Pépin, écrivain guadeloupéen
- SCIENCES PO AIX-EN-PROVENCE SE SOUVIENT DE SES ANCIENS ETUDIANTS
- 2è édition revue et augmentée du "Dictionnaire du créole martiniquais"
- Decolonizing futures
- L'Hôtel du Bon Plaisir
Depuis toujours :
- Le grand livre des proverbes créoles
- Les stupéfiantes facultés divinatoires de Concept Lapierre, voyant du Morne-des-Esses
- LA DIFFERENCE CONCEPTUELLE ENTRE LA NEGRITUDE, L'ANTILLIANITE ET LA CREOLITE
- Raphaël Confiant
- Césaire fut "anté-créole" et pas "anti-créole"
Visiteurs
- Visites : 1247910
- Visiteurs : 91245
- Utilisateurs inscrits : 48
- Articles publiés : 309
- Votre IP : 216.73.216.37
- Depuis : 09/05/2022 - 19:37